


144

067

068

079
087

185
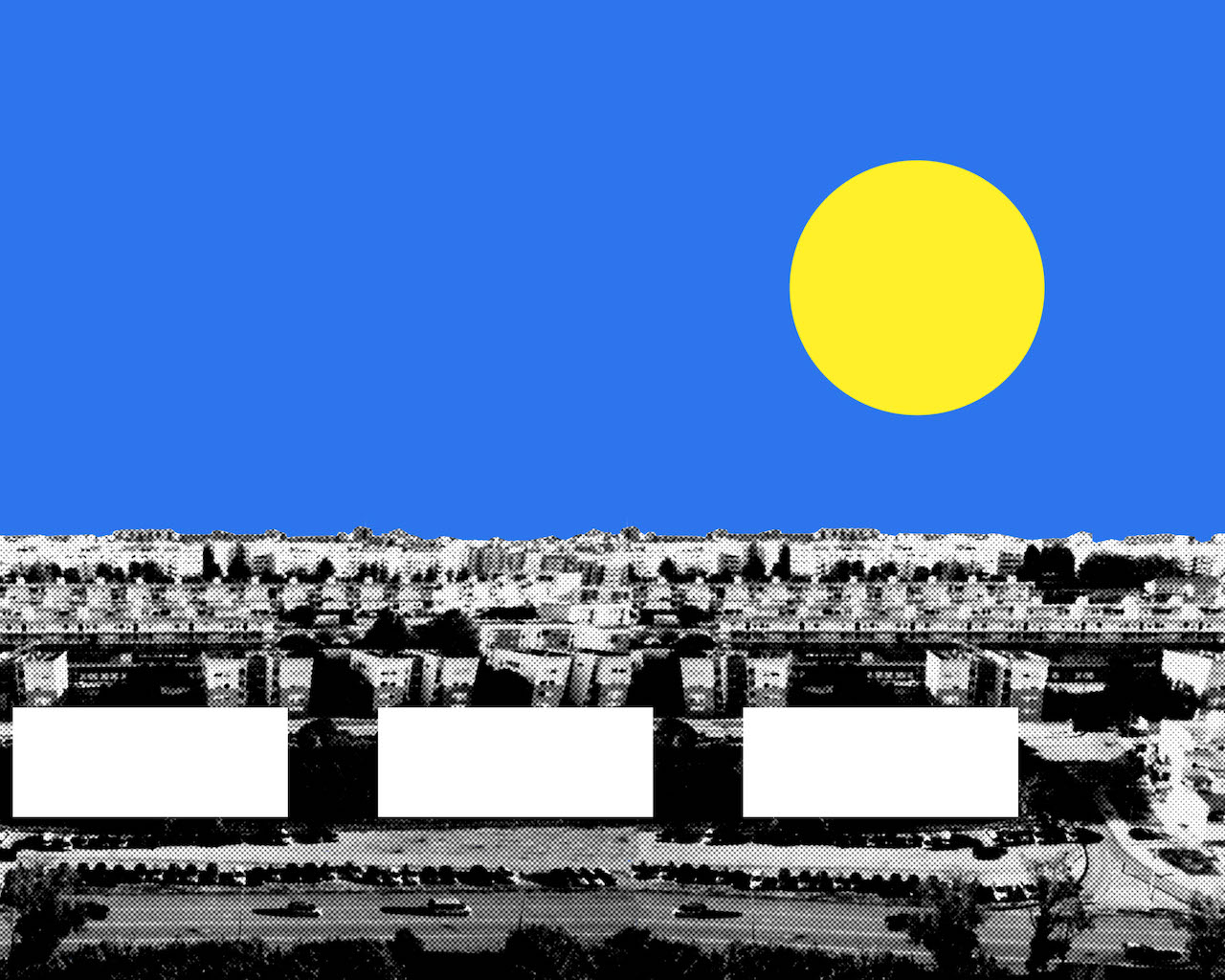
173

a+u

097

082

150
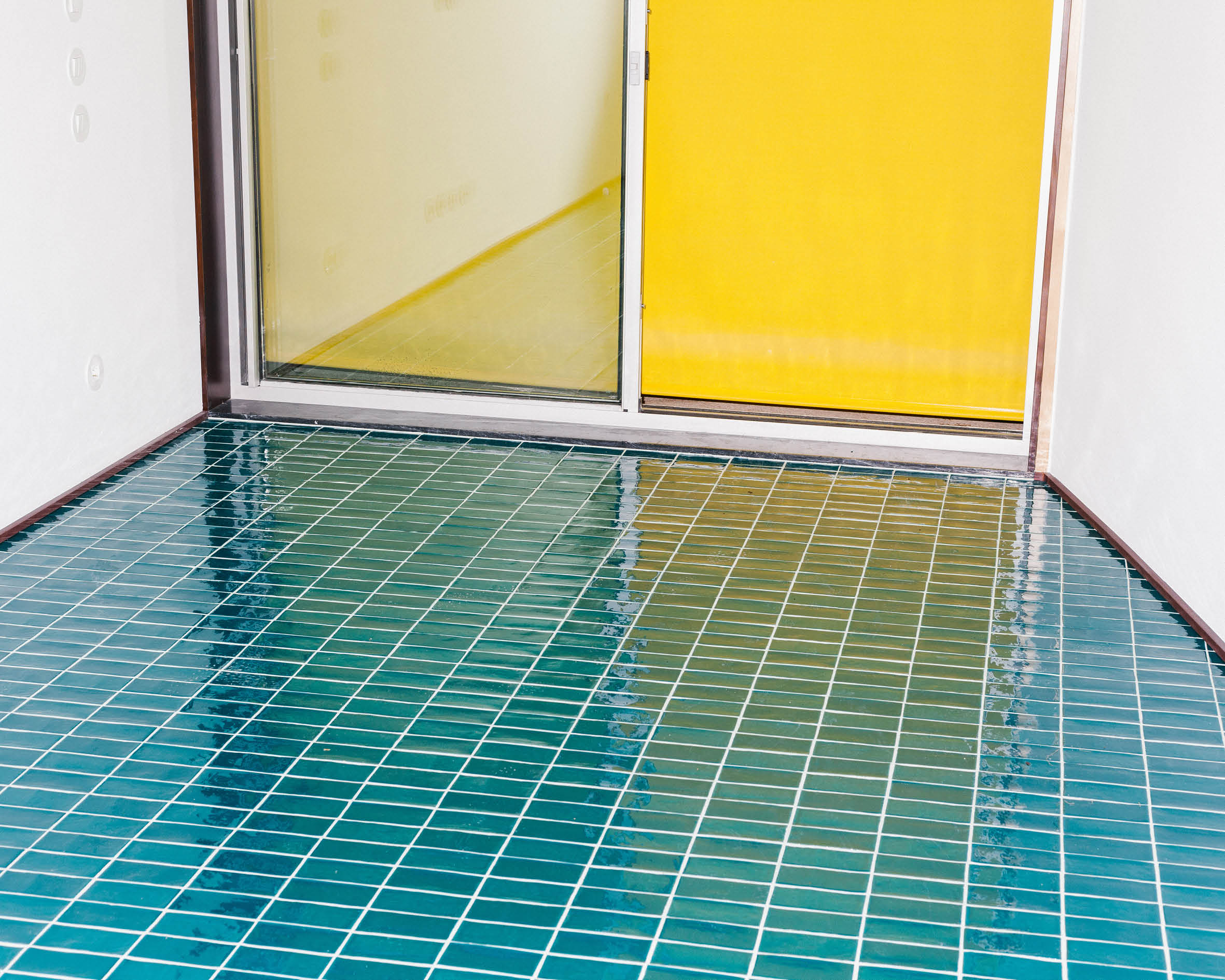
114
125

023
102

094

143

118

077

156

101
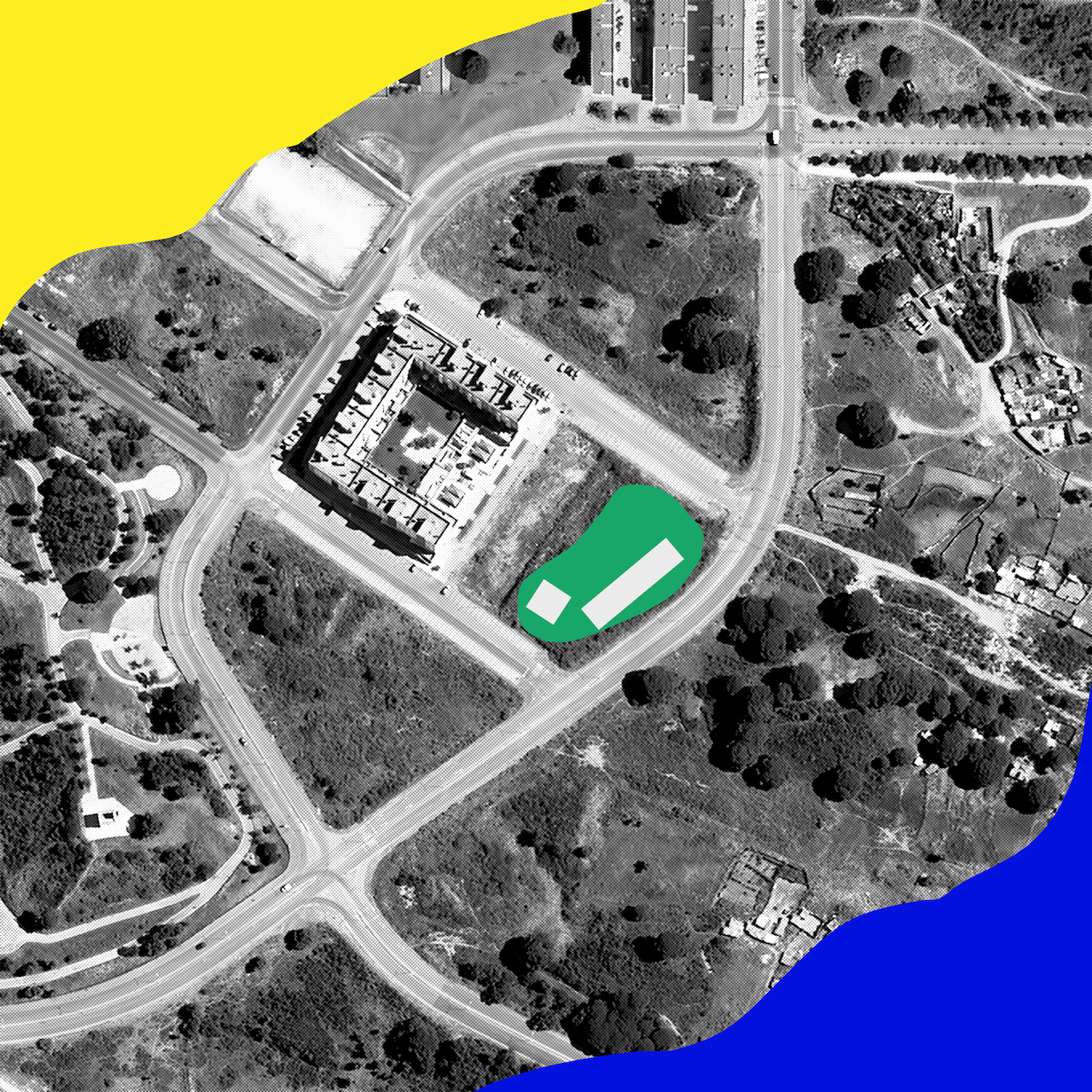
172

075

048
182

136
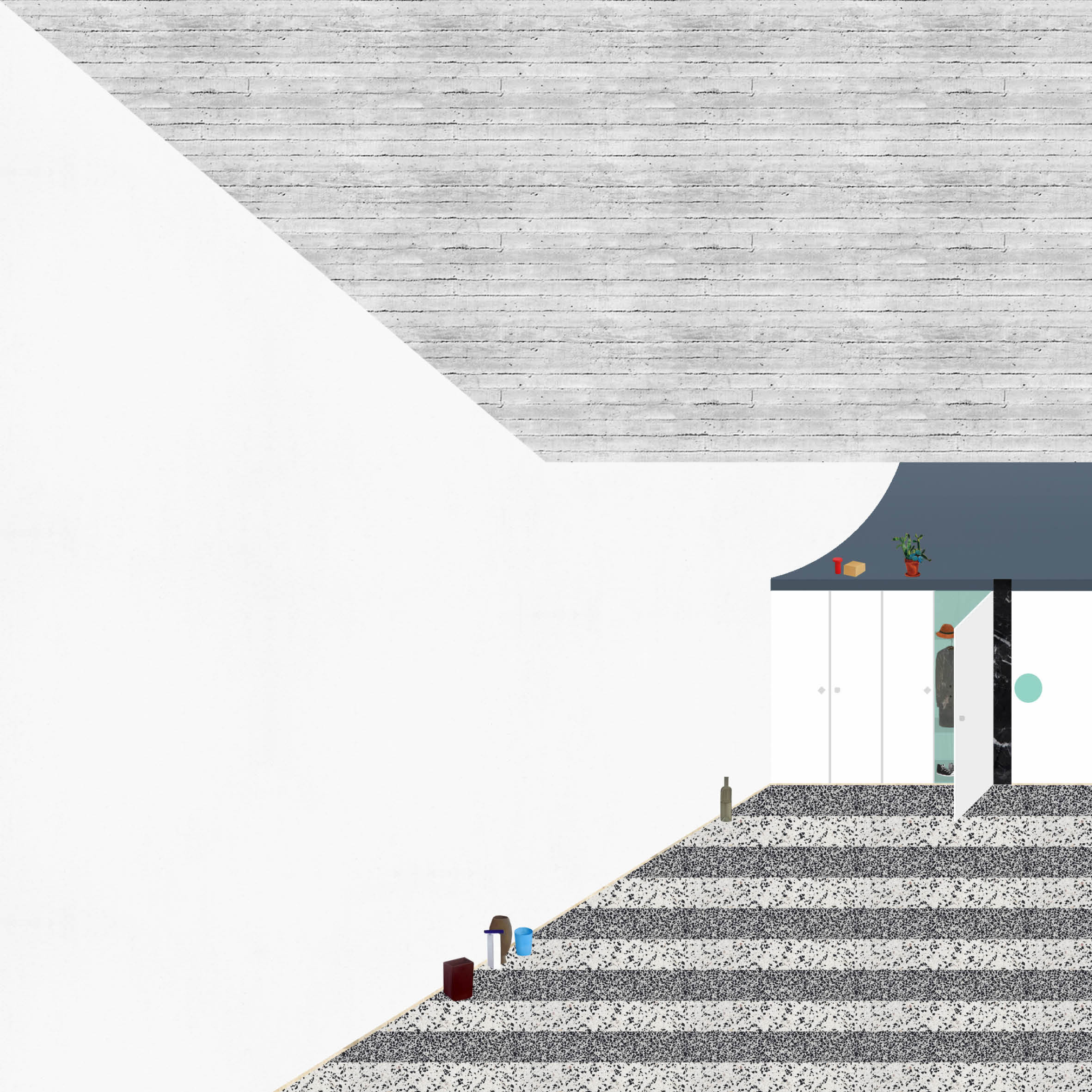
085

030

090

189
